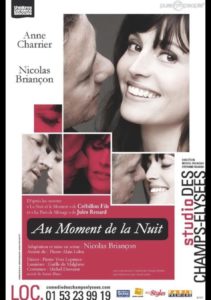Seul sur scène, en marcel et parfois enveloppé d’une cape se tient Olivier Broda, devant la voile d’un navire sur laquelle se projette une silhouette d’homme qui marche, sans doute Fernando Pessoa, dans une rue de Lisbonne peut-être, « Lisbonne avec ses maisons, De différentes couleurs, Lisbonne avec ses maisons, De différentes couleurs… A force d’être différent, ça devient monotone. » Les images projetées dévoilent aussi le comédien lui-même, enfant, avec sa tante, pour donner de la vie et de l’épaisseur à ce je singulier et démultiplié.
Olivier Broda incarne deux alias de Pessoa : Bernardo Soares ou Alvaro de Campos, l’auteur de Bureau de Tabac, ce texte court et formidable où le poète analyse le monde de sa fenêtre, en particulier ce bureau de tabac qui lui fait face. « Je ne suis rien. Jamais je ne serai rien. Je ne puis vouloir être rien. Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde. »
Comme son titre l’indique, ce spectacle est un voyage dans la nuit de l’insomnie. Le poète, seul dans sa chambre, rêve sa vie, songe au monde, à la ville, aux visages des passants à la manière de Rilke, imagine des voyages toujours reportés à la façon du héros de Huysmans dans A Rebours. Les voyages imaginaires, les voyages de l’intérieur, c’est de cela que parle Pessoa.
Poète de la difficulté d’exister, poète de la solitude et de l’insomnie, poète de la marche et de l’errance comme Walt Whitman, Pessoa use de mots concrets, simples pour dire la prégnance et l’absurdité du quotidien. Cette langue nous est offerte ici avec une énonciation irréprochable. Certes la diction du comédien est un peu théâââtrale, mais son intonation change, et cette voix particulière, au timbre imprégné d’échos qui parfois portent un peu trop loin pour une si petite salle, ne faillit sur aucun mot, y compris quand son débit s’accélère.
Olivier Broda a des airs de Laurent Terzieff, cet autre grand amoureux des poètes (ah, son interprétation des Carnets de Malte chez Pivot). Il dit le texte avec passion, plonge dans ses analogies, montre la vie comme un train, la course de l’existence de gare en gare, de port en port : « Nous vivons tous ici-bas au bord d’un navire parti d’un port que nous ne connaissons pas et voguant vers un autre port que nous ignorons. Nous devons avoir les uns envers les autres l’amabilité de passagers embarqués pour un même voyage » (Le livre de l’intranquillité).
Il est aussi question de génie inconnu : « Un génie ? En ce moment / cent mille cerveaux se voient en songe génies comme moi-même / et l’histoire n’en retiendra, qui sait ?, même pas un »… Dans le délire insomniaque surgissent une série d’oppositions et d’états inconciliables entre soi et l’autre, le tout et le rien, la nuit et le jour qui, peut-être, va naître – et l’on pense à ce magnifique titre d’Emily Dickinson, Y aura-t-il pour de vrai un matin ?
Sous l’effet de cette déclamation classique, un brin affectée mais irréprochable, plus aucun filtre ne semble s’interposer entre nous et la substance métaphysique de la langue, si bien traduite, de Pessoa.