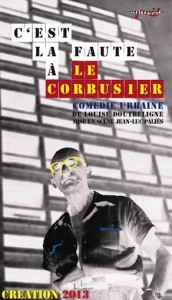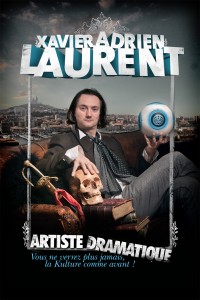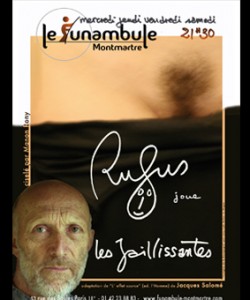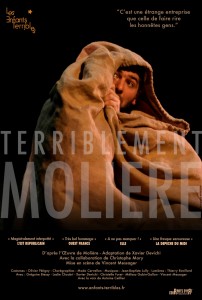Rilke est un poète de la ville, de l’errance, de la solitude. Il éprouve son existence dans un sentiment d’altérité, à travers cette frontière poreuse qui le sépare des autres, de ce monde obscur et inquiétant dont les échos résonnent en lui démultipliés. Sa solitude est cernée par la limite entre l’intérieur et l’extérieur, et son cœur est trop petit pour contenir tout ce qu’il ressent. Sur une scène sombre, recouverte de quelques cailloux qu’on croirait copeaux de charbon, un jeune homme parle, se livre, ressent. La main droite crispée pour soutenir une élocution emphatique, Jérémie Sonntag dit une sélection de poèmes de Rilke et des passages des Carnets de Malte Laurids Brigge, dont Laurent Terzieff avait livré à la télévision une interprétation extraordinaire.
Il ne s’agit pas d’une lecture, mais d’une mise en scène pluridisciplinaire qui cherche à rendre la sensation poétique par des sons vibrants et des images projetées sur le T shirt blanc du comédien, son visage, la toile de fond. Il y a des formes mouvantes comme un souffle, du flou et du net, une matière visuelle, vivante, minérale et organique… Quelques sons résonnent comme des cailloux dans l’eau, échos d’existences minuscules, traduisant la perception extralucide du poète, plongé dans un état d’hyperesthésie au monde. On ressent le silence, « l’existence du terrible dans chaque parcelle de l’air », la foule dévalant les rues, tous ces visages différents, plus nombreux qu’il n’y a d’être humains, chacun en possédant une panoplie.
Oui, c’est de la poésie oralisée, une performance sensitive qui se réalise sur une scène… Mais elle s’énonce d’une façon classique et, au fond, assez peu contemporaine. Peut-être cela vient-il des traductions de Rilke, avec leurs formules désuètes, ces « que ne vous ai-je », « que ne me suis-je » qui figent le texte dans un passé révolu… Et malgré un dispositif visuel et sonore très contemporain, on a l’impression d’une poésie métaphysique engoncée dans des codes anciens. La citation mise en exergue de l’affiche a beau être parfaitement choisie – « je n’ai pas de toi qui m’abrite et il pleut dans mes yeux » -, la pluie et le vent ne s’invitent pas dans la salle.