Bourlinguer est une œuvre majeure de Blaise Cendrars (1887-1961), l’auteur de la Prose du Transsibérien, poète voyageur et témoin du 20e siècle, né suisse et devenu français, parti en Russie à 17 ans et à New-York six ans plus tard d’où il ramènera un poème fondateur de la poésie moderne, Les Pâques à New York. Un ami de Cocteau, Jouvet ou Picasso, engagé volontaire dans la légion pendant la première guerre où il perdit un bras, un aventurier comparable à ce chercheur d’or auquel il a consacré un récit, L’Or, souvent porté à la scène. Lorsqu’à 61 ans il écrit quatre récits autobiographiques comme autant de romans-poèmes, Cendrars donne à voir un monde où il s’est toujours engagé corps et âme.
Dans le premier des onze récits de Bourlinguer – dont le dernier est un extraordinaire portrait du port autonome de Gennevilliers, ses darses et ses conteneurs, tel aujourd’hui qu’à l’époque, intitulé « Paris Port-de-Mer » -, l’auteur se rappelle son enfance passée sur un magnifique coteau de Naples, le Vomero, que son père se mit à construire et urbaniser, déplorant sa métamorphose en une juxtaposition mesquine de terrains cloisonnés lorsqu’il la retrouve à vingt ans, épuisé, après s’être fâché avec l’armateur grec qui l’employait. Retrouvant le paradis perdu de son enfance, il s’enterre dans le sol meuble d’un enclos où il jouait jadis avec une petite fille, à côté du tombeau de Virgile. Tout lui revient en mémoire, les joies, l’éveil des sens et un deuil tragique suivi d’une de ces processions napolitaines où tout le monde se mêle, mendiants et estropiés, avec ce sens du tragique qu’ont les gens de là-bas.
 L’écriture est foisonnante, belle, circulaire, généreuse, précise. Jean-Quentin Châtelain, également suisse et trimbalé enfant sur les routes d’Europe par ses parents, porte la parole du poète dans la mise en scène de Darius Peyamiras qui l’avait dirigé en 1986 dans Mars de Fritz Horn (prix du syndicat de la critique). Au Grand Parquet, cette ancienne salle de bal posée à la lisière des jardins d’Éole qui borde la voie ferrée de la gare de l’est, un lieu qui aurait plu à Cendrars, le comédien se tient debout, menton haut, les yeux fermés souvent, face aux spectateurs. Immobile, complètement immobile durant une heure et demie, les deux pieds ancrés dans le sol et sans bouger d’un orteil, Jean-Quentin Châtelain est drapé dans une gabardine à la façon du Balzac de Rodin, planté au sol comme une statue, un arbre dont la sève monte, une vieille bâtisse.
L’écriture est foisonnante, belle, circulaire, généreuse, précise. Jean-Quentin Châtelain, également suisse et trimbalé enfant sur les routes d’Europe par ses parents, porte la parole du poète dans la mise en scène de Darius Peyamiras qui l’avait dirigé en 1986 dans Mars de Fritz Horn (prix du syndicat de la critique). Au Grand Parquet, cette ancienne salle de bal posée à la lisière des jardins d’Éole qui borde la voie ferrée de la gare de l’est, un lieu qui aurait plu à Cendrars, le comédien se tient debout, menton haut, les yeux fermés souvent, face aux spectateurs. Immobile, complètement immobile durant une heure et demie, les deux pieds ancrés dans le sol et sans bouger d’un orteil, Jean-Quentin Châtelain est drapé dans une gabardine à la façon du Balzac de Rodin, planté au sol comme une statue, un arbre dont la sève monte, une vieille bâtisse.
Le comédien articule le texte avec une force et une scansion particulières, un peu suisse, un peu traînante, où chaque mot a été mâché et résonne à plein régime. « J’aborde les monologues en les répétant, en les maniant dans tous les sens, en les psalmodiant, en les ânonnant. J’ai parfois l’impression que je passe le texte à la machine à laver. A force de le répéter, le sens nous parvient. C’est comme une prière », disait-il à une journaliste de L’Hebdo en juillet 2005. Oui, il psalmodie les mots de Cendrars pour les faire parvenir, amples et profonds, à nos oreilles chantournées.
Tout en donnant beaucoup, il disparaît derrière le récit duquel Cendrars, lui-même, s’efface en faisant résonner ses souvenirs.




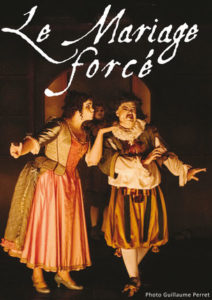
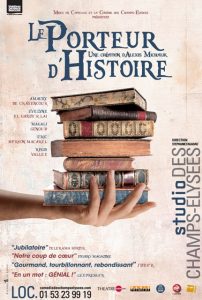




Pingback: Une saison en enfer de Rimbaud, par Jean-Quentin Châtelain - CRITICOMIQUE