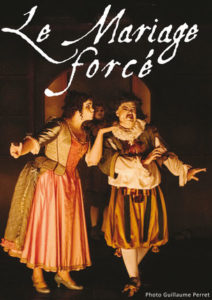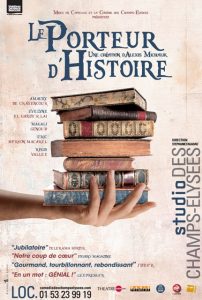Comme Wajdi Mouawad, Joël Pommerat, l’un des grands auteurs de théâtre vivant, écrit ses pièces sur le plateau. Avec Ma chambre froide, on retrouve la même patte, le même style inimitable, à la David Lynch, que dans Je tremble et Cercle fiction, la même piste circulaire où plongent les regards, le même réalisme délivré des conventions théâtrales usuelles, la même sonorisation puissante et cinématographique, les mêmes rêves mis en scène, avec cette inquiétante étrangeté onirique qui semble trouver un accès à l’imaginaire des spectateurs.
C’est un théâtre du réel. Ma chambre froide décrit la vie, dans une entreprise de viande, d’un patron infect et de ses employés, parmi lesquels cette fille qui se plie à la volonté des autres, Estelle (incroyable Ruth Olaizola), personnage inquiétant et romanesque, ambigu, dont on ne sait si elle est une sainte, ou, petit à petit, un monstre. Par touches apparemment insignifiantes mais essentielles, elle se révèle. Estelle pense si peu à elle que ça en devient suspect. Plus la pièce avance, plus les spectateurs – comme les personnages – se rendent compte qu’ils ignorent qui elle est.
Assez vite, le patron apprend qu’il va mourir. C’est imminent. Il fait avec ses employés un pacte presque méphistophélique : il leur lègue tout, ses quatre entreprises, non seulement la chambre froide mais aussi la cimenterie, l’abattoir et le bar de luxe. En échange, il exige que ceux-ci rendent hommage à sa mémoire une fois par an. Estelle décide qu’ils créeront pour lui une pièce de théâtre qui lui permettra, avant sa mort, de l’aider à voir une part de la réalité qui lui est cachée. Cette idée essentielle peut être vue comme une métaphore du théâtre de Pommerat : il s’agit de montrer le réel sous une forme qui rende visible un aspect du monde dérobé à la conscience du spectateur.
Entre les scènes montrant ces employés qui deviennent patrons et tous les paradoxes que ça suppose, il y a ces répétitions oniriques d’une pièce aux costumes enfantins, avec ses personnages aux têtes d’animaux ou d’enfants hypertrophiés qui rappellent les séquences Rabbits de David Lynch. Les scènes, courtes, s’enchaînent par rapides fondus-enchaînés sur ce plateau circulaire qui, parfois, tourne, donnant à voir aux spectateurs la scène de tous les angles possibles.
Ma chambre froide procure des émotions, de l’angoisse, mais aussi des rires chaque fois que parle cet employé d’origine chinoise à l’accent tellement inintelligible qu’Estelle est seule capable de le comprendre. On est scotché à son siège devant ce théâtre circulaire dont le son et les images prennent corps et s’enchaînent avec la fluidité de sentiments mêlés. Tous les stimuli reçus se réalisent, mimétiques d’une réalité frissonnante ; l’artifice s’estompe et le théâtre retrouve cette force qu’il avait perdue avec l’avènement du cinéma.